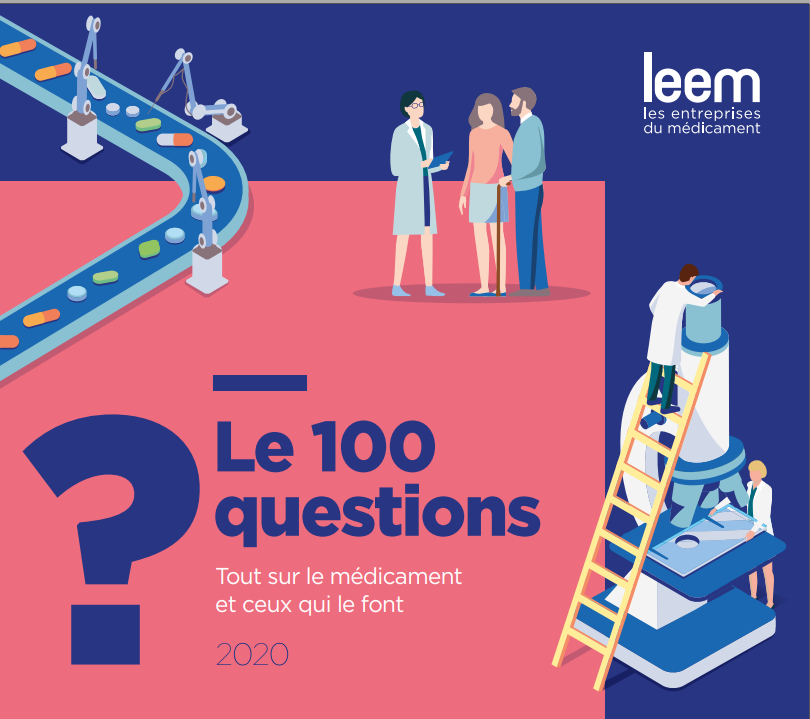Le médicament, secteur stratégique
Actions de groupe en santé : une arme pour les usagers du système de santé français ?
Quatre ans plus tard, ce dispositif, complexe et inadapté, livre un bilan mitigé voire décevant.
Depuis 2016, seules 12 actions de groupe ont été lancées en France tous secteurs confondus
(Source : syndicat de la magistrature, décembre 2019)
● La loi du 18 mars 2014 relative à la consommation (dite loi Hamon) a introduit en droit français l’action de groupe en matière de consommation.
● Ce dispositif de type « class action » a ensuite été étendu à la santé par la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016.
● L’objectif de l’action de groupe est l’indemnisation des préjudices corporels subis par plusieurs usagers du système de santé.
● Le dispositif d’action de groupe permet à des associations, agréées au niveau national ou local, d’introduire une action en justice au nom d’un groupe d’usagers du système de santé français.
● Dans un rapport de décembre 2017, la Cour des comptes a souligné les « limites du dispositif » actuel des actions de groupe.
● Le nombre d’actions engagées est faible, notamment en raison de la complexité et de la longueur de la procédure. La première action de groupe, engagée en octobre 2014 par l’association de consommateurs UFC-Que choisir contre l’administrateur de biens Foncia, n’a connu un jugement en première instance que quatre ans plus tard.
● Autre contrainte : ces procédures se révèlent coûteuses pour les usagers. Il faut compter, en moyenne, 50 000 euros (1) pour le lancement d’une procédure, notamment afin de rémunérer les personnes chargées de préparer le dossier et payer les frais d’avocat.
● La commission des lois de l’Assemblée nationale a décidé, le 10 juillet 2019, la création d’une mission d’information sur le bilan et les perspectives des actions de groupe.
Elle a pour objet de dresser un bilan de cette procédure et d’émettre un certain nombre de recommandations en ce qui concerne, par exemple, les domaines dans lesquels ce type d’action peut être engagé, ainsi que les acteurs à qui ce droit peut être reconnu.
Les deux rapporteurs, Laurence Vichnievsky (Modem, Puy-de-Dôme) et Philippe Gosselin (LR, Manche), présenteront leurs travaux courant 2020 après avoir auditionné avocats, magistrats, universitaires ou encore représentants d’associations agréées ou d’organisations patronales.
Le Leem a été auditionné par la mission parlementaire le 11 février 2020.
- (1)D’après l’association Familles rurales
● Les entreprises du médicament souscrivent à l’objectif d’amélioration et de simplification des procédures de réparation des dommages.
● Elles s’interrogent cependant sur la capacité de ce dispositif à répondre à cet objectif de manière plus satisfaisante que les procédures d’indemnisation existantes au travers de l’Oniam (2)
● Les entreprises du médicament soulignent également le caractère inadapté des actions de groupe à la réparation des préjudices corporels, qui peuvent différer de manière considérable d’une personne à une autre.
La réponse à un traitement peut varier selon les individus (de symptômes mineurs et temporaires à un état pathologique grave).
La réparation des dommages corporels nécessite donc des évaluations et des expertises individuelles.
- (2)Instauré par la loi Kouchner du 4 mars 2002, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) a pour mission de faciliter l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux.